À propos
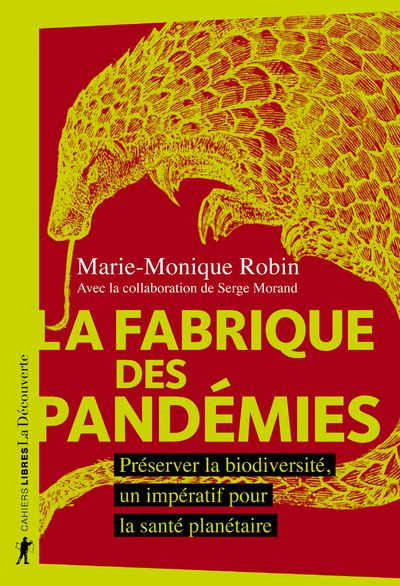
Le chaos et ses indicateurs
Par Bruno Marzloffen November 2021 - 
Cette critique d’ouvrages reflète les préoccupations de notre équipe. Ainsi l’ignorance des alertes des scientifiques du monde entier sur La Fabrique des pandémies résonne avec celles que nous portons sur les excès de mobilités et nos propositions du côté des démobilités. Nous pensons résolument qu’il existe des issues à la Fabrique de l’impuissance qu’évoque Amitav Gosh. D’autres formes de mobilisations existent. De même que La Fabrique des mobilités fait sienne l’exigence de disposer d’indicateurs pertinents que défend également l’ouvrage ou encore les analyses de l’économiste Éloi Laurent. Car mesurer, c’est aussi choisir ce qu’on entend vivre.
Quand la diversité garantit la santé
« Il n’y a nul doute sur le fait que les oiseaux ont un point de vue sur la pandémie. Si le confinement nous permet de mieux entendre les oiseaux, pourquoi ne pas entrer en conversation avec eux ? » interpelle Vinciane Despret. Leur disparition nous effondre et nous interpelle. À la fois espèces en extinction, menaces comme vecteurs du virus, mais aussi sentinelles en veille, les oiseaux illustrent la thèse de La Fabrique des pandémies (La Découverte, 2021).
Une maladie infectieuse émergeait en moyenne tous les 15 ans avant 1970 au niveau mondial. Nous en sommes au rythme de 4 à 5 par an désormais, rappelle Marie-Monique Robin. Son livre, décrypte les mystères d’une biodiversité qui, à l’œuvre depuis la nuit des temps, a protégé l’humanité. Les mécanismes de ses équilibres prennent à revers les tenants d’une modernité qui voudraient éliminer les agents pathogènes. Mais là surgit un paradoxe. La diversité et l’intensité de ces agents est, plus qu’une litanie de vaccins, la garantie de notre santé. Cette alchimie repose sur la régulation naturelle de leur environnement. Des forêts brûlées, des zones inondées, d’autres saccagées, des industries et autres nuisances anthropiques détruisent ces biotopes, subtiles et fragiles balances entre les vivants, plantes, animaux et humains et déchaînent leurs vices potentiels dans une chorégraphie de transmission complexe et fatale. L’ouvrage explore les manières qu’à l’homme de maltraiter ces biotopes, et analyse in fine les conséquences directes et indirectes sur la santé de tous leurs habitants. Nourri des lumières de 62 scientifiques de disciplines et d’origine multiples, servi par une pédagogie impeccable et une écriture fluide, le propos donne à voir la pandémie dans sa profondeur en remontant aux sources (synthèse dans ce podcast. Mais sa vertu essentielle est d’amener le lecteur à s’abstraire de la gluante actualité sanisécuritaire des vaccins, masques et autres confinements, à décoller nos regards des pesantes courbes de contaminations pour repenser nos postures face à la crise sur des fondements robustes et à réfléchir aux manières d’y répondre et d’éviter d’entrer dans une vie sous la menace chronique du dernier variant ou du virus inédit. Sans oublier que ce combat pour la biodiversité dépasse la question de la santé pour s’ouvrir sur la survie de l’humain.
L’alerte ne fonctionne pas
« Nous savions », disent nombre de scientifiques et c’est le premier enseignement de l’ouvrage. Ils savaient, ils disaient, ils publiaient, ils annonçaient en toute lucidité scientifique, parfois depuis des décennies. Ces scientifiques avaient vu juste depuis belle lurette. Leurs cris se perdaient dans les brumes des mauvaises nouvelles qu’on occulte. Nos sociétés ont un rapport bizarre avec le chaos et ses alertes. Elles en conjurent les apocalypses. Elles s’énervent face aux collapsologues. Elles surinvestissent la rhétorique du danger quand il advient et récusent les semonces qui permettraient de le traiter. Puis elles font œuvre de déni quand l’orage est passé. « La crise ne doit pas laisser de traces », ose benoîtement l’économiste Jean Pisani-Ferry à propos du coronavirus. L’issue est-elle coincée entre déni, fatalité ou solutionnisme ? Des ventilateurs géants à Delhi pour combattre les effets délétères du climat ! Quant à ceux qui gouvernent, leurs analyses sont aspirées par des échéances d’une autre temporalité. Que vaut la fonte des glaces face aux prochaines élections ?
L’indiscipline des usages face à l’impasse publique
Sommes-nous face à une « fabrique de l’impuissance » se demande Amitav Gosh dans Le grand dérangement (Le Monde Qui Vient, 2021) ? Se pourrait-il que « le changement climatique, par sa nature même, constitue un problème insoluble pour les nations modernes » ? Pourtant des initiatives à l’échelle du local et des communautés affrontent ces détresses en activant « l’indiscipline des usages » pour reprendre la belle expression de Vinciane Despret ("Habiter en oiseaux" Actes Sud, 2019). « N’ayez pas peur. Il n’y a plus rien à perdre », entonne bravement le collectif Catastrophe* (Puisque tout est fini, alors tout est permis, paru dans Libération en 2016). « Au lycée, on nous avertit d'emblée que l'Histoire était finie […]. Nous n'en connaissions pas le visage que déjà, nous n'avions plus le droit d'y croire. » Pourtant, ils caracolent : « La réponse est simple : renaître, comme il nous plaira […] Le monde est une pâte à modeler, pas cette masse inerte et triste pour laquelle il passe. Des futurs multicolores nous attendent. »
“Rien ne nous oblige à vivre comme ça », martelle Marielle Macé dans cet indispensable opuscule Nos cabanes (Verdier 2019) qui brode ses espoirs autour de ce manifeste et qui crédite la génération qui l’écrit, la chante et l’active d’un formidable appétit politique, hors des sentiers battus … dans ce « monde du nous » que l’autrice développe avec autant de conviction que de poésie (le podcast). Au-delà des nécessaires communs, ces cabanes sont des manières de faire et de se projeter ensemble, de nouer des alliances. Singulièrement l’une d’entre elles, la ZAD des confins de l’estuaire de Nantes, est un des rares points d’appui d’une imaginable sortie par le haut. Cette subversion qui a mobilisé au fil du temps des dizaines de milliers de militants peut se lire comme « une insurrection de l’imaginaire » (Édouard Glissant). À cet égard, Notre-Dame-des-Landes fait figure de laboratoire d’une autre modernité. « La zone qu’ils défendent est précieuse, conclut la romancière Virginie Despentes. C’est l’espace infime dans lequel on se souvient qu’autre chose est possible. » Ce « laboratoire des fragilités » fascine philosophes, anthropologues, architectes, écrivain.e.s et cristallise une pensée politique neuve. David Graeber – Il introduit l’ouvrage collectif Éloges des mauvaises herbes (en lecture libre) autour d’une douzaine d’intervenant.e.s – rappelait que « l’imagination est une force en politique », un cri porté en 2008 par sa tribune Hope in common, à un moment où le combat entre aéroport et terres agricoles était déjà largement engagé. Le combat soldé par le retrait du projet s’ouvre sur la suite politique « l’aéroport finalement c’était rien, c’est maintenant que ça compte », fait dire Alessandro Pignocchi à un des personnages de sa BD. Le chercheur rend compte de sa joyeuse découverte de la ZAD et l’analyse dans une attachante bande dessinée, à lire absolument. Le titre est programmatique, La recomposition des mondes (Anthropocène Seuil, 2019). Il s’accorde sur ce sujet avec l’anthropologue Philippe Descolas pour en considérer l’enjeu politique, la transformation de nos regards sur le vivant et cette audace ontologique de la « société du nous » et son étrange « pouvoir de cicatrisation » (le podcast). Tandis qu’une équipe conduite par l’architecte Patrick Bouchain se penche sur les cabanes et leurs « écritures poético-pratiques inouïes [qui] suggéraient des manières de vivre totalement inattendues » (Notre-Dame-des-Landes ou le métier de vivre, Loco 2018).
Des indicateurs pour penser le monde
« Alors que l’humain commence à comprendre que son rationalisme hégémonique le conduit tout droit à la catastrophe, la nécessité de réinstaurer un dialogue intime avec le vivant se fait jour, » commente Nicolas Santolaria (Comment le poulpe a conquis l’humanité) dans une édifiante série que Le Monde a consacrée cet été aux « penseurs du vivant ». Ces voix alternatives montent enfin en haut de l’affiche car leurs analyses résonnent avec les intuitions de l’opinion. Pourtant quelques colonnes plus loin dans le même quotidien, on s’afflige toujours des désordres de la croissance, voire de son malheureux recul. Face à la domination de l’économique, perpétuelle contradiction dans laquelle s’engluent toutes les mutations avortées.
Dans un podcast consacré à La Fabrique de la pandémie, un scientifique rappelle les coûts en milliers de milliards de dollars du coronavirus, et mentionne qu’une prévention ne coûterait qu’un petit pour cent de ces dépenses. Le problème ? Ces sommes sont indolores pour le système qui en intègre vicieusement un profit via le PIB, miroir de nos contradictions et obstacle insurpassable à des ruptures obligées pour affronter entre autres le défi de la biodiversité. « La comptabilité nationale considère comme utiles toutes les productions y compris les plus toxiques », rappelle la sociologue Dominique Méda (Le Manifeste travail, Seuil, 2020). Toutes ces dépenses de masques, de vaccins, de soins, de test, lits d’hôpitaux, etc. font croître artificiellement l’économie et participent curieusement de la croissance. C’est comme ça qu’on compte le progrès. “Le concept de croissance économique est un non-sens total, affirme Malik Peiris qui a isolé le virus du SARS. Les économistes et les politiques ne savent pas compter ce qui compte." L’indicateur universel, toujours contesté mais jamais remis en chantier, nous envoie dans le mur.
« Mesurer c’est choisir »
Au moment où on s’interroge sur les raisons qui retiennent les gouvernements dans l’audace d’aborder le destin d’une planète abimée et un futur à recomposer, la question des indicateurs est cruciale. Ainsi les milliards d’euros jetés dans la bataille sanitaire du « quoi qu’il en coûte » agissent certes sur le symptôme mais font grimper la croissance (et la dette). Alors pourquoi investir dans la prévention ? L’économie n’est pas à sa place. Elle qui prétend organiser une cité maîtrisée la fait sombrer dans la dystopie. L’urgence est donc de changer d’indicateurs. “Un indicateur est une vision du monde, un index qui pointe ici plutôt que là et sert à définir des priorités politiques en portant le regard sur certaines apparences pour en ignorer d’autres. Mesurer, c’est choisir" (tribune de l’économiste Éloi Laurent, auteur d’un ouvrage sur le lien entre croissance et santé Et si la santé guidait le monde ? (Les liens qui libèrent, 2020).
Dans le champ qui est le nôtre à La Fabrique des Mobilités, les compteurs s’affolent en inflation structurelle de déplacements motorisés, en débordement d’émissions de gaz à effet de serre et autres polluants, en torrents de vies perdus directement en accidentologie, ou indirectement en santé détruite, en artificialisation obligée du territoire, en dépenses inconsidérées d’infrastructures délétères pour la planète, et tant d’autres catastrophes que la civilisation d’une mobilité carbonée a générées. La démobilité – dont La Fabrique se réclame promoteur –, n’est pas mesurée pour sa part. Il serait pourtant pertinent d’en évaluer les incidences et les bénéfices des évitements et réductions de déplacements, d’entendre les attentes de mobilités choisies, d’en relever les gains en qualité de vie, d’évaluer les performances des mobilités de proximité, de comprendre comment le travail à distance impacte nos déplacements et nos modes de vie, d’apprécier les effets d’une logistique de livraison en croissance, etc. Mais c’est peut-être aussi l’occasion de faire, comme dans La fabrique des pandémies, le lien des mobilités avec ce thème crucial de la santé, et de s’interroger sur un autre monde. C’est l’objet d’une réflexion sur les indicateurs que nous entreprenons et dont vous pourrez suivre les travaux.

